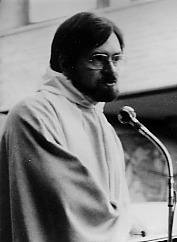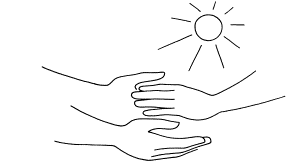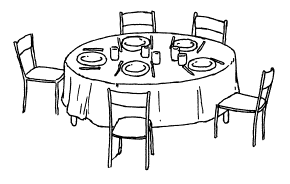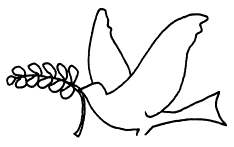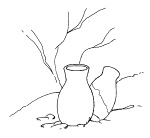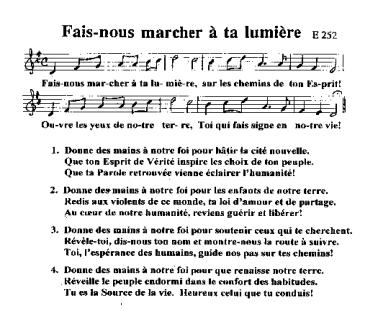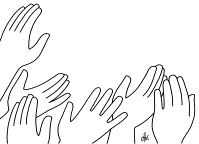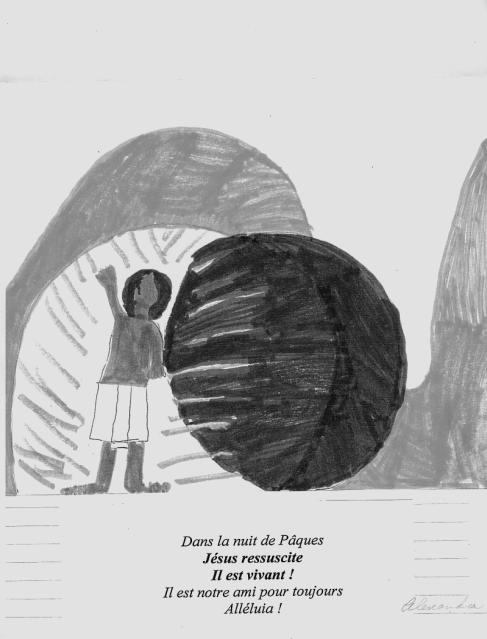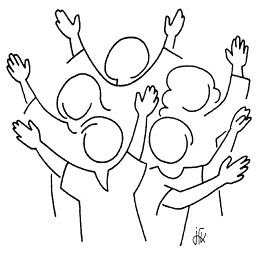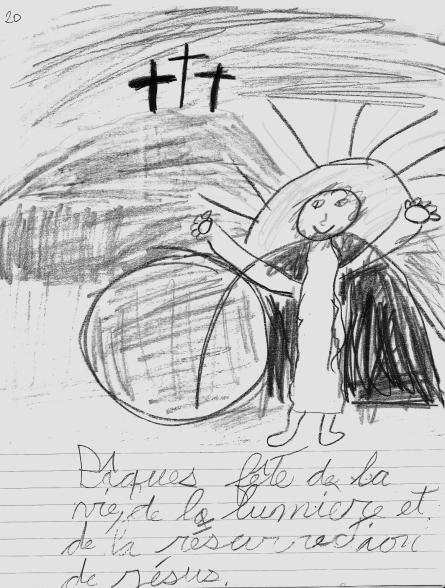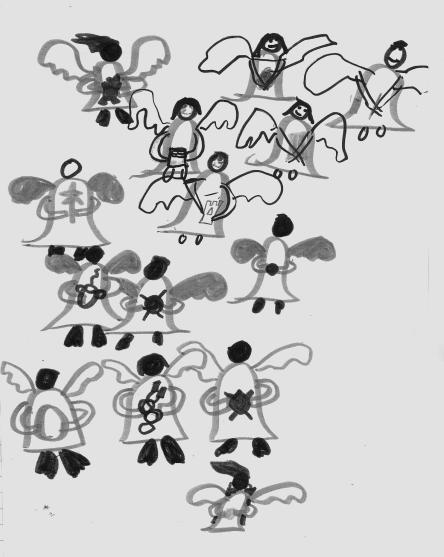|
Communauté chrétienne Saint-Albert-Le-Grand à Montréal |
Étapes Pâques - 2006
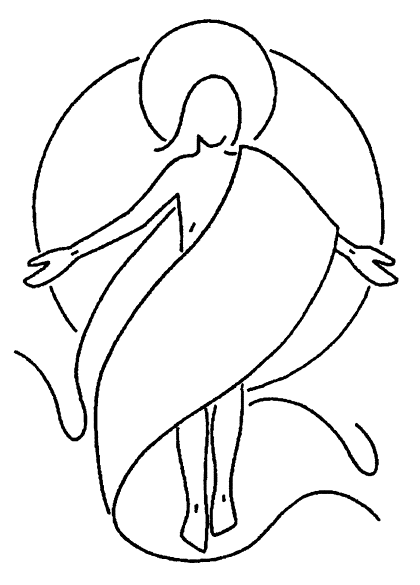
Communauté Chrétienne Saint-Albert-le-Grand
Autour de Pâques
Une foi qui a des mains…*
Nous
vivons dans un temps où le nom de Dieu est servi à toutes les sauces, souvent
pour justifier l’injustifiable. Or, il me semble que le souvenir de la résurrection de Jésus nous rend plus
humbles. Elle nous apprend qu’on ne doit pas se servir de Dieu. Il nous faut
plutôt laisser surgir des personnes et des groupes humains qui travaillent,
chacune et chacun à leur façon, à donner des mains à leur foi et à ressusciter le monde. C’est la seule
façon de devenir des passeurs de
vie.
|
|
Impossible
de fêter Pâques sans faire passer la vie à travers l’aventure de femmes et des
hommes qui cherchent tout simplement à vivre. Dieu nous y accompagne. Dans son
inlassable travail de passeur de vie, Jésus semble avoir tout perdu. Il finit
dans la mort, cloué comme quelqu’un à qui on a tout pris. Ou plutôt comme quelqu’un qui a tout donné! Les
passeurs de vie se servent de leurs mains pour faire des brèches dans les murs,
dans le mur de la mort, de toutes
les morts. On les reconnaît assez facilement. Ils inventent la convivialité,
créent des lieux et des moments de gratuité de la vie, ouvrent des chemins inédits
de résurrection.
Ces
gens qui ont un coeur et des mains, on en rencontre souvent et de mille manières. Le plus souvent dans des
petits gestes où ils manifestent
le souci du bien-vivre ensemble. La résurrection du Christ n’est-ce pas là
qu’elle se vit, qu’elle s’invente, qu’elle appelle à la vie.
Quand
dans la nuit de Pâques, nous proclamons notre foi en la vie, derrière les mots
priés et chantés, presque toujours les mêmes, il y a aussi des expériences de
vie et de foi différentes. Mais le sens et la force de la proclamation seront dans les liens qui nous
unissent. Et quand nous échangeons les voeux de Pâques au coeur de la
célébration, j’ose croire que dans
les yeux de chacune et de chacun brillera une lumière vivante. Et Pâques nous
enverra encore une fois à notre quotidien, telle une découverte toujours à
vivre. « Souvenons-nous de Jésus Christ ». Joyeuses Pâques à tous les
membres la communauté!
Guy Lapointe
* Ce texte s’inspire de celui que j’ai
publié dans le Magazine Présence, février 2006, S-7.
En souvenir de lui…
André
Gignac
(1931-1981)
André Gignac est né à Québec, le 25 janvier 1931, et il y a
fait ses études primaires et secondaires. Après avoir étudié au Petit Séminaire
de Québec, il entre à la Faculté de philosophie de l’Université de Laval, puis
au Collège dominicain de philosophie et de théologie. Il complète sa formation
théologique à Chambéry (Haute-Savoie) où se trouve le Collège des Dominicains
de la Province de Lyon (1954-1957). Il est ordonné le 17 mars 1956. Puis il
fait un séjour à l’Institut supérieur de liturgie de l’Institut catholique de
Paris. Il a accumulé un B.A., un B.Ph., une maîtrise en théologie et une
maîtrise en liturgie.
De
retour au pays, il partage son activité entre l’enseignement, la recherche, les
publications et l’activité pastorale. À partir de 1960, il est professeur à
l’Institut de pastorale (Montréal) ; il a été professeur invité à
l’Institut des Études médiévales, à l’Institut supérieur des sciences
religieuses, à l’Institut de catéchèse, au Grand Séminaire de Trois-Rivières, à
la Faculté des Dominicains d’Ottawa ; il a animé un grand nombre de
sessions en pastorale liturgique. Il a été, pendant quelques années, chargé de
recherche à temps partiel à l’Office national de liturgie (Montréal).
Aux
éditions du Cerf (Paris) il a publié en 1974-1975, les trois tomes de Quand
l’espoir se fait
Parole, puis en 1978,
Célébrer le Pardon.
Il a participé à la rédaction de rituels, de guides, de directoires, de
recueils de prières ; les titres comprennent les mots suivants qui
reviennent fréquemment : mariage, confirmation, baptême, enfants,
eucharistie, etc.
Il a collaboré activement à plusieurs revues soit comme
secrétaire de rédaction, soit comme directeur : Communauté chrétienne, où il fut
co-directeur, Liturgie et vie chrétienne, Dimanche et fête.
Il a été de 1969 à 1981 responsable-prêtre de la Communauté
chrétienne Saint-Albert-le-Grand.
Il est décédé subitement à Paris le 25 avril 1981.
La
communauté dominicaine St-Jean et la communauté chrétienne St-Albert se remémoreront
l’héritage spirituel d’André Gignac et les traces de sa présence parmi nous,
par une eucharistie et un échange, le 24 avril , de 19h à 21h , au salon de la
communauté St-Jean. Bienvenue aux intéressés !
L’héritage d’André
Gignac
Lors du
départ d’André, une phrase se répétait ici et là, comme un leitmotiv :
|
|
«Il faut que ça continue !» Que
souhaitions-nous alors ? Nous souhaitions que la communauté continue de
vivre et de s’épanouir et que les célébrations qui en constituaient le cœur
demeurent toujours signifiantes et revitalisantes. Nous voulions être de plus
en plus une communauté qui se nourrit de l’Évangile et qui célèbre la mémoire de
Jésus ressuscité en tenant compte de la vie de ses membres et de leurs
engagements quotidiens. Une assemblée liturgique bien incarnée,
quoi !
André
créait chacune des célébrations dans un esprit de grande liberté. Bien qu’il soit toujours demeuré très
respectueux de l’institution pour laquelle il a longtemps travaillé comme
membre de l’Office national de liturgie, il n’hésitait jamais à accorder la
priorité à la vie plutôt qu’aux rituels officiels. La vie était au cœur de
la liturgie comme la liturgie était au cœur de sa vie. Tout était imprégné du
sens de la fête.
De
nature plutôt timide, au début du moins, il a su faire œuvre commune en s’entourant de collaborateurs
et collaboratrices : confrères dominicains (particulièrement Guy Lapointe)
et laïcs de tous âges (Jeannette Boulizon, Jacqueline Tremblay et tant
d’autres) qui ont créé avec lui les aménagements nécessaires aux célébrations
et qui ont continué par la suite avec d’autres personnes arrivées plus tard. Il
faut dire aussi, qu’en avril 1981, la communauté comptait 23 groupes ou comités
dont plusieurs commençaient à voler de leurs propres ailes, à la grande joie
d’André. Certains de ces groupes durent encore, d’autres sont disparus ou sont
nés. Ainsi va la vie !
André
choyait aussi beaucoup les enfants et passait de longues heures à créer des
temps de Parole qui soient signifiants pour eux. Les enfants étaient heureux de
rencontrer les « amis du dimanche»
et ils se sentaient bien chez eux dans l’église.
En
somme, célébrer aujourd’hui la mémoire d’André Gignac, n’est-ce pas célébrer du
même coup notre communauté chrétienne ? N’est-ce pas aussi nous lancer à
chacun, à chacune un défi pour les années à venir ? Faire en sorte que la
Parole continue de se faire Espérance, une espérance qui traverse même la
perspective de la mort, une espérance qui imprègne toute notre vie quotidienne
et soit porteuse d’une fécondité sans cesse renouvelée.
Thérèse
Dufresne
Pour humaniser notre foi :
une présence auprès des femmes itinérantes
|
|
1.
Présentation de
Madame Léonie Couture , fondatrice et directrice de cet organisme ;
2.
Compte rendu du
dîner communautaire du 12 mars où elle était invitée.
Présentation :
Permettez-moi
d'abord de situer mon lien par rapport à la Rue des Femmes. Après un engagement de plusieurs
années au Rwanda, ma réinsertion au Québec m'a rendue attentive aux problèmes
de société d'ici. Entre autres, mon «voir» quotidien dans les rues du quartier
où j'habite et aux entrées de métro, m'a mise en contact avec des situations intolérables au
regard : le monde de l'itinérance. Jeunes et adultes, hommes et femmes en perte
de leur humanité faisaient surgir beaucoup de questions en moi : Qui sont ces
personnes au visage défiguré ?
D'où viennent-elles ? Quel drame personnel vivent-ils-elles ? Quelles
sont les causes de ce phénomène grandissant dans une société dite «d'abondance»
?
Voilà
le genre de questions qui m'a amenée au local de LA RUE DES FEMMES, alors situé au 3720 Avenue du
Parc, dans le désir de comprendre plus à fond cette problématique. C'est ainsi
que j'ai été accueillie par la
directrice Madame Léonie Couture.
|
|
Assez
vite, j'ai pris conscience de l'engagement des initiatrices de ce Centre car je
suis arrivée dans une période creuse (manque de subventions, manque de
personnel, manque de ressources pour répondre aux besoins des femmes). Deux de
ces femmes, dont Léonie, divisait leur maigre salaire en deux pour permettre
au Centre de garder la tête hors de l'eau ! Cette petite anecdote
illustre
bien la détermination de Léonie et la compréhension du drame de tant de femmes
vouées à l'itinérance. Bien vite j'ai découvert en elle une femme de coeur, de respect,
de compassion et de foi en la capacité de la personne de se mettre debout et de
reprendre le pouvoir sur sa vie. J'étais donc à bonne école !
Je
vous présente donc Madame Léonie Couture, directrice générale et Madame Suzanne
Bourret, coordonnatrice générale de La Rue des Femmes, organisme sans but lucratif agréé
depuis 1994. Le Centre a connu un
heureux développement depuis 2002, en particulier par des supports importants
qui ont permis d'acquérir enfin une maison d'accueil plus adéquate, la Maison
OLGA située au 1050 rue Jeanne-Mance.
Je
me réjouis aussi de savoir que l'organisme a une porte-parole depuis 2002 en la
comédienne Lynda Johnson, sachant que c'était un désir cher au coeur de Léonie
! Cette porte-parole est certainement un bon appui pour trouver les ressources
nécessaires afin de tout mettre en oeuvre pour que des femmes retrouvent leur
dignité, leur fierté, leur autonomie. Léonie, à toi la parole !
Marie-Paule
Lebel
Compte rendu du dîner communautaire du 12 mars 2006
|
|
Madame
Léonie Couture, fondatrice et directrice générale de « La rue des
Femmes », était notre invitée pour l’occasion. Léonie est d’origine
beauceronne et a vécu en Outaouais avant de s’établir à Montréal. Elle a fait
des études universitaires en actuariat, en administration et en psychothérapie
qui ont orienté ses engagements à la Commission de la fonction publique du Canada,
dans des Centres de santé, en alphabétisation, au Mouvement contre le
viol, et au conseil d’administration de la Fédération des femmes du Québec. En
1994, sa réflexion féministe débouchait, avec l’appui d’un collectif de femmes,
sur la fondation de « La Rue des Femmes de Montréal ». Six ans plus
tard, la Maison Olga était érigée rue Jeanne-Mance et une autre phase est à
l’étude. C’est dans le ton d’un partage d’expérience que Léonie a répondu aux
questions qu’à sa demande Paule-Renée Villeneuve lui posait à propos de sa
fondation et de l’itinérance des femmes.
1. D’abord, dites-nous ce qu’est « La
Rue des Femmes » ?
« La
Rue des Femmes de Montréal » est un lieu où des femmes viennent se
retrouver. L’idée de cette fondation lui est venue après un certain nombre de
prises de conscience. Par exemple, en aidant dans un programme
d’alphabétisation et autres, elle a rencontré des personnes profondément
blessées et acculées au stade de la survie. Devant certaines conséquences de la
discrimination faite aux femmes, elle s’est posé le défi suivant :
« Si dans mon militantisme féministe, je ne fais pas quelque chose, je
manque mon coup. »
Compte
rendu du dîner
communautaire du 12 mars 2006, (suite)
2. Qui sont ces femmes que l’on retrouve
chez vous et comment y arrivent-elles ?
Elles
arrivent dans la rue parfois dans le cadre d’une émigration difficile, souvent
à la suite de brisures, de fractures dans l’ordre de l’exclusion. Sous l’effet
de la violence et de la souffrance, l’estime de soi est détruite. Par
exemple : pour une dame, un jour il lui fut trop difficile de rentrer dans
son appartement, où il lui semblait entendre des voix de torture déjà subite.
Devant l’intolérable, elle a jeté ses clés dans le canal afin d’être sûre de ne
pas y revenir. Pour nous, l’important est de dépasser nos conventions pour
accueillir ce monde souffrant. Des hommes aussi ont des parcours aussi
intolérables. Ces personnes font face à une question de survie et non de choix.
Il est important pour nous de les accueillir en croyant en elles, en les
amenant à découvrir leur place et leur mission bien à elles.
3. Que peut-on faire comme société au sein
d’une problématique aussi forte ?
Même
si les subventions sont souvent remises en question, des personnes qui veulent
s’y engager arrivent toujours à point : que ce soit pour l’accueil ou le
centre de jour et ses activités de toutes sortes .
Au
milieu de tant de monde en détresse,
que faire pour que ça n’explose pas ? La patience mutuelle est
nécessaire. Par exemple, dans une ambiance explosive, je me mettais à faire des
dessins. Les personnes me rejoignaient lentement en se pacifiant. Elles ont
besoin d’être écoutées et incluses dans quelque chose. Une table bien préparée
peut attirer graduellement même celle qui ne veut pas manger.
|
|
Humaniser
les problématiques. Voilà ce que nous pouvons faire. La trop grande souffrance
est derrière la toxicomanie et autres. Ce sont des mécanismes
de survie. On
peut
commencer à cheminer avec ces personnes souffrantes en les aidant à reconnaître
leur « fracture ». Sur le plan physique, la société est organisée
pour ces soins. Mais sur les autres plans, elle doit cheminer pour ne pas
exclure la personne blessée. Tout en accompagnant ces personnes, nous sommes
amenées à nous aimer comme des personnes qui s’apportent mutuellement un
surplus de vie, ce qui guérit la fracture ou recrée le lien. Avec ce lien, la
personne itinérante peut revenir à l’humanité. Parfois, le lien est tellement
blessé, qu’elle ne veut plus souffrir. Il devient alors difficile pour
l’intervenant de faire face au problème, puisqu’il a lui-même été blessé et y
reconnaît quelque chose de lui-même. On a besoin de développer ensemble des
moyens de s’accueillir soi-même. Vivre une relation saine avec soi-même et
entre nous pour l’apporter aux autres, c’est le remède principal. Être là pour
accueillir l’autre, ne pas s’imposer et faire confiance en ses capacités. La
vie est toujours prête à pousser.
En
deuxième partie, les questions des participants ont permis d’approfondir les
points suivants :
1. Le financement : La recherche de
fonds se fait en tout temps. Généralement, on peut dire que la moitié est
gouvernementale et le reste vient
du public. Si nous avions à faire campagne, nous utiliserions peut-être ce
slogan qui nous a déjà interpellées : « Un dollar pour une
femme en difficulté réveille davantage qu’un café ! » Chacune et
chacun sont invités à offrir leurs coordonnées pour une liste d’envoi ou pour
visiter le site de l’organisme qui est le suivant :
http://www.laruedesfemmes.com
2. L’encadrement offert : La rue des
Femmes est comme un petit hôpital avec du personnel 24 heures sur 24, 7
jours sur 7 et deux personnes par quart de travail.
Dans
le contexte montréalais, où 28,000 personnes sont identifiées dans le besoin,
13,000 sont sans abri, dont le quart sont des femmes. Nous accueillons plus de
30 femmes par jour pour les activités et le couvert alors que nous en abritons
20. Dans une année, nous hébergeons 400 femmes pour une durée plus ou moins
longue selon les cas. En les accueillant chacune, nous reconnaissons déjà que
pour certaines, ce sera plus long. De façon régulière, ce sera pour un à deux
mois. En cours de route, on peut prolonger jusqu’à un an et on a six ou sept
lits pour ces séjours à moyen terme. Nous avons aussi cinq ou 6 lits pour
des séjours plus longs d’un an à
deux ans.
Les
personnes qui s’y présentent sont de différents niveaux de vie (même médecin)
et de tous les âges. Les plus jeunes, nous les référons aux centres de jeunes
et à la DPJ, où elles se retrouvent mieux. Plusieurs femmes sont issues de
communautés culturelles diverses, selon la réalité montréalaise. Des défis se
présentent, tels les cas d’excision. Le manque de ressources, la crainte de
perdre leurs enfants amènent les femmes à attendre longtemps avant d’aller à la
rue, tout en perdurant avec beaucoup de médicaments. Notre solution, c’est
l’inclusion. Faire de la place à tout le monde, c’est aimer.
Au
nom de l’assemblée, Sœur Marie-Paule Lebel a remercié Léonie pour son
témoignage de foi confiante et humaine accompagnée d’un engagement portant les
mêmes couleurs, pour « re-figurer en humanité » cette société dont
nous sommes.
|
|
Pauline Boilard, m.i.c.
(secrétaire)
|
|
Joyeuse spontanéité
Enlève,
Seigneur, mon cœur de pierre,
Donne-moi
un cœur de chair!
En
gagnant en liberté, il advient qu’on s’humanise davantage. Dès lors, ai-je la
conviction que plus on se laisse
inspirer par la Pâque de Jésus,
plus on désire vivre la joie du don, de
l’engagement. C’est avec Timothy Radcliffe, dans son dernier
ouvrage :
« Pourquoi
donc devenir chrétien? » (Cerf, 2005), que je poursuivrai cette
réflexion.
Son
chapitre « Apprendre la spontanéité (pp. 45-71) » ouvre, me semble-t-il, une voie pascale à notre liberté la plus authentique. Pour
l’auteur, la liberté comme choix entre diverses alternatives relèverait de
l’avoir. « Il nous faut
discerner une liberté plus profonde, c’est alors ce que nous sommes ».
« La
spontanéité ne consiste pas à faire la première chose qui nous passe par la
tête. Elle consiste à agir à
partir de ce qu’il y a de plus profond en notre être, là où Dieu nous maintient
en vie. Pensons à la totale
spontanéité de Jésus… sa liberté la plus profonde était de ne pouvoir faire
autre chose que la volonté de son Père… En faisant sienne cette nécessité,
Jésus est suprêmement libre, car ce qu’il fait exprime ce qu’il est au plus
profond de lui-même ».
« Ceci est mon corps, livré pour
vous »… tout ce que Jésus a été jusque-là menait à cela… C’est à la fois
ce qu’il devait faire et ce qu’il fait absolument librement ».
Jésus
est le modèle de cette spontanéité.
Notre liberté la plus profonde est aussi de faire la volonté du Père. « … une spontanéité comme celle-là
est le fruit d’un dur travail, d’une renaissance ». En ressuscitant, Jésus nous a ouvert
ce passage!
|
|
« La liberté est l’espace où
nous pouvons éclore ensemble; la liberté de la spontanéité est fondée sur la
communion entre Dieu et l’humanité sur laquelle repose notre existence. La
liberté de donner notre vie aspire à la communion de toute l’humanité dans le
Royaume. »
Entrer
en communion avec tous doit donc déboucher sur une solidarité, un partage, une
vie ouverte et toute fraternelle.
Communier à la Résurrection du Christ vivant, voilà la véritable
renaissance où, à travers mille gestes – mains et cœurs ouverts –, on met sa
disponibilité à l’œuvre, on fait comme Jésus, on donne sa vie pour finalement
permettre à ce qui est bon et vivant en nous, – et qui vient de Dieu –, de s’exprimer.
« C’est
alors que nos actes nous appartiennent vraiment, totalement, sans aucune
entrave extérieure; nous pouvons faire ce que nous désirons le plus
profondément et où nous trouvons le plus de plaisir, et qui est aussi le plus
totalement l’action de Dieu car tout ce que je fais surgit de Dieu. Il n’y a plus de compétition ».
Huguette Teasdale
La
Cruche Fêlée
Laissez-moi
vous raconter un conte Soufi des Indes ….
|
|
Un homme, chaque jour, porte l’eau de la rivière à sa maison. Il a deux cruches : une est parfaite, l’autre est fêlée et perd de l’eau en route à travers de petites fissures. Quand l’homme arrive chez lui, elle est déjà à moitié vide et l’homme doit retourner encore une fois à la rivière. Jour après jour, il en est de même.
Enfin
la cruche lui parle : « Pourquoi ne me jettes-tu pas? Je perds de
l’eau et tu dois travailler plus fort et pour rien, à cause de moi.
Débarrasse-toi donc de moi ! »
« Mais
non » répond
l’homme, « tu ne comprends pas, parce que ton œil ne voit que le ciel.
Regarde donc la terre, que vois-tu? Sur le chemin suivi avec la cruche
parfaite, elle est poussiéreuse et sèche, mais les fleurs abondent là où je
suis passé avec toi. Quand je me suis rendu compte que tu étais fêlée, j’ai mis
des graines dans la terre et chaque jour, en revenant de la rivière, je les arrose. Chaque jour,
en passant, je me réjouis de leur beauté et cette joie éclaire toute ma
vie. »
Bienheureux,
les êtres fêlés; ils laissent passer la lumière!
Christine Mayr
|
|
Couplets : Muguette Lavallée.
Des mains ouvertes vers toi, Seigneur…
Interpellée
par le « visuel du fameux drapé bleu », je ne peux m’empêcher de
m’interroger sur la manière de donner des mains à ma foi de chrétienne, en ce
carême 2006. Or, selon moi, être
chrétienne c’est croire à
la bonne nouvelle du salut, mais aussi avoir confiance dans la fidélité de Dieu à ses
promesses, espérer sa
miséricorde et en témoigner par
de simples gestes d’amour.
« Par
l’amour, mettez-vous au service les uns des autres (…) Marchez sous l’impulsion
de l’Esprit » . Ga 5,13 & 16.
Être
chrétienne, c’est donc avoir l’assurance d’être toujours aimée de Dieu et
savoir que je ne l’aime jamais assez!
Donner des mains à ma foi reviendrait alors à multiplier mes gestes d’amour,
faire en sorte que je devienne plus disponible et solidaire : à Dieu, pour accueillir en moi l’action de son Esprit
d’amour; à Jésus, pour le voir dans l’autre que je côtoie au fil des jours; aux
autres, pour rester à leur écoute et contribuer à leur bien-être, selon mes
moyens; à moi-même aussi, pour sauvegarder ma liberté face aux contingences de ma
vie…
Donner
des mains à ma foi, à partir de ce carême 2006, consistera donc à développer,
dans la mesure du possible, ma capacité de choisir d’aimer à chaque
instant…Tendre vers un peu plus de patience, de douceur et de bonté; modérer
mes réactions, réduire mes révoltes ou mes colères et rester à l’écoute..
|
|
Des
mains ouvertes, par Toi, Seigneur, pour recevoir Tes multiples
bienfaits;
des
mains ouvertes, vers Toi,
Seigneur, pour
t’offrir chaque geste de ma journée;
des
mains ouvertes, avec Toi,
Seigneur, pour
partager les joies et les souffrances côtoyées;
des
mains ouvertes, pour Toi, Seigneur, qui me combles inlassablement et sans compter.
Hayat Makhoul-Mirza
Leçon des ténèbres

Les
chars montent à l’assaut dans la poussière de la savane, broyant les corps déjà
inertes, écrasant huttes et jardins.
Dans
les pleurs et le sang, tes enfants cheminent vers un destin improbable.
Mon
âme est triste jusqu’à la mort.
La
pitié nous a failli, la haine nous a été fournie en surcroît.
Tout
autour de nous s’accumulent les corps déchiquetés par les roquettes,
démembrés
par les grenades. Le mortier tonne, les mines éclatent sous les pieds des
enfants.
La
guerre traîne avec elle l’épuisement et la faim.
La
faim nourrit la maladie, la maladie alimente la mort.
Le
sang lui-même n’est plus un véhicule de vie, il devient un poison pour le
malade.
C’est
notre propre génie qui propage la destruction, plus ingénieux sommes-nous à
briser qu’à bâtir.
Notre
invention apporte la mort comme elle pourrait distribuer la vie.
Judas
a de nouveau vendu la chair de son Seigneur pour une poignée de deniers.
Monnaie
ridicule, billets déjà dépréciés au gré des places de finances, risible salaire
du sang.
La
peur envahit nos veines, Seigneur, nos artères charrient un sang glacé.
Seigneur,
pourquoi nous as-tu abandonnés ?
Le
soldat, roi lui-même sur le champ des ruines, est devenu un automate ; ses
gestes ne sont plus que la caricature de la vie.
Rictus
du joueur qui a perdu sa mise, rire jaune du tricheur qui n’a plus rien à
jouer.
Le
cercle étroit du plaisir s’est refermé sur l’amertume et la mort.
Cette
heure est noire et sans la lueur d’un improbable jour.
Seigneur,
le Mont des Oliviers est une terre immense, sans horizon.
Jérusalem
est soumise à la noirceur des cœurs.
La
haine s’est assise en reine sur la colline de David.
La
grenade a transformé la fillette en bouillie, l’obus a décapité le vieillard.
Le
mortier a fait éclater dans le cœur des vivants le désir de la vengeance.
Le
cri du corbeau a étouffé le chant du coq.
Des
pays déchirés viennent les chants douloureux des rescapés, dans nos murs monte
le gémissement du désespoir.
Notre
Père nous a-t-il abandonnés à nos démons impitoyables.
Apprentis
sorciers, pervertis, ne pouvons-nous semer que la douleur ?
La
mort est-elle le juste salaire de la vie ?
Seigneur,
mon âme est triste jusqu’à la mort.
Et
pourquoi, pourquoi nous as-tu abandonnés ?
Seigneur,
où irons-nous, sans Toi ?
Simon
Paré
Thème de la
retraite
Oka, PRINTEMPS
2006
RÉSURRECTION est une sorte de slogan
dans lequel les chrétiens des premières communautés se reconnaissaient. Il
disait l’orientation de leur vie, il traçait la lignée dans laquelle ils
s’inséraient, il pointait vers l’avenir. Mais il ne disait pas tout, car il
allait de soi, à l’époque, qu’on ne pouvait ressusciter qu’à l’intérieur d’un
cosmos nouveau. Les choses, la nature, les animaux, tout cela faisait partie
de l’espérance, tout cela serait transformé et accompagnerait un jour les
humains renouvelés.
Tout cela se passerait ici-bas…
Comment redirions-nous notre
espérance, aujourd’hui, si nous partions, non pas avec des mots anciens, mais
de l’élan de notre espérance, de la poussée intérieure qui nourrit notre amour
de la vie au jour le jour?
Y aurait-il des liens à faire entre nos humbles mots et
ceux de jadis? (note)
Y a-t-il une ‘’passion’’ (dans ses deux sens : amour
puissant et source d’engagement… donc
de souffrance) dans notre vie, qui pointe vers un monde
neuf ?
André Myre
(note) Résurrection :
résurgence, fait de faire revivre en esprit, de ressusciter (le passé)
passer de la mort à la vie (au sens mystique).
Après le départ de Jésus, dans son entourage, quel sens prend ce
mot?
Et dans les temps subséquents? Et dans le temps présent?
PARCOURS de L’ANIMATEUR:
André Myre a été membre de la Compagnie de Jésus de 1960
à 1997.
Il détient un doctorat du Hebrew
Union College de Cincinnati et est bibliste depuis 1970.
Il a enseigné l’exégèse à la Faculté
de théologie de l’Université de Montréal jusqu’à sa retraite en 1997.
Il est membre du Conseil éditorial de la Bible
(nouvelle traduction) Mediaspaul-Bayard, 2001.
Auteur de nombreux ouvrages inspirés de la Parole, il
anime des groupes populaires avec lesquels il vit sa foi et partage sa vision
d’une Église renouvelée.
Quelques titres de ses ouvrages :
Écoutez ce que je vous dis. Le Sermon sur la montagne,
2002
Maintenant la Parole, 2004
Ô miracle ! Jésus et les malades, 1997
Ciel ! où allons-nous ?L’au-delà dans la
tradition chrétienne, 1991
Scandale ! Jésus et les pauvres, 1993
Voir Dieu de dos, 2000
Un souffle subversif .L’Esprit dans les lettres
pauliniennes, 1987
|
|
Prières
et dessins d’enfants de l’École Buissonnière
Seigneur,
guéris-moi quand je pleure.
Soulage-moi
avec de la joie.
Veille sur
moi quand je suis avec toi.
Aide-moi
quand je ne peux pas.
Tu es mon feu et tu brûles toujours.
Avec
toi, tu me réchauffes tous les jours.
Tu es ma vie,
tu es ma plante.
Je t’arrose
souvent et tu deviens géante.
Tu es ma
mère, tu es la mer.
Et moi, je
suis ta rivière.
Tu es le
vent, tu es le ciel.
Et toi tu es
ma cannelle.
Tu es ma
petite fleur de lys
Et moi
je suis ton fils
|
|
.
Benjamin
Cher Papa du
ciel,
Je t’offre ma
famille
Je t’offre
mon cœur pour que tu le nettoies
Pour qu’il
soit blanc, blanc comme le tien
Priez pour
tout le monde dans l’univers.
Tallulah
Paix
Paix en toi,
Dieu
Au plus haut
des cieux
Toi qui nous
a créés
Avec amour et
liberté
Merci de nous
aider
A devenir
meilleurs à chaque journée
Tu nous
redonnes confiance
Dans nos
moments de souffrance
Tu nous
redonnes la liberté
Quand nous
sommes persécutés
Merci, Père,
d’avoir créé
Tout ce monde
bien-aimé!
Sandrine
|
|
|
|
|
|
Bulletins ÉTAPES
Responsable :
Élizabeth Roussel, eroussel@videotron.ca
Mise
en page : André H. Rinfret, andre.h.rinfret@sympatico.ca
Accueil Homélies Organisation Événements Célébrations Plan du site En haut