 |
Communauté chrétienne Saint-Albert-Le-Grand à Montréal |
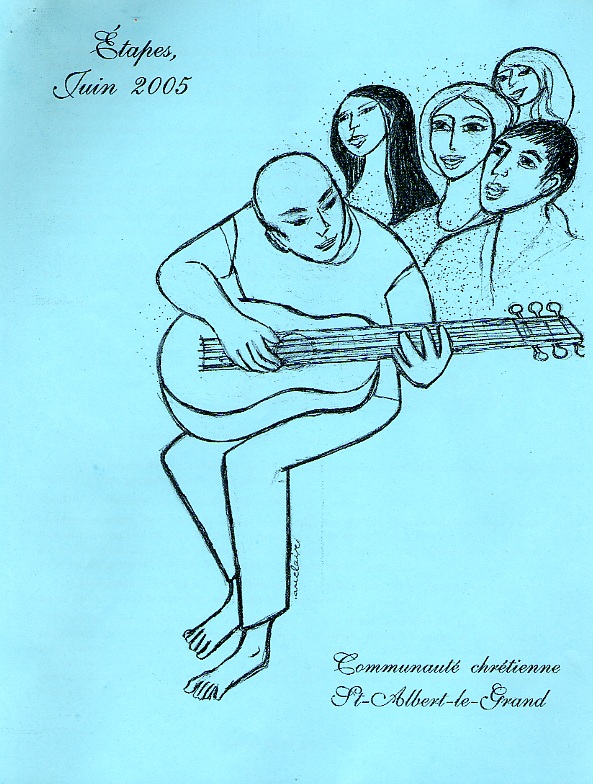
Le bulletin Étapes de juin 2005 foisonne d’articles témoignant de la richesse et de la diversité de la vie de St-Albert.
Il y a d’abord cette porte qui s’ouvre sur notre « maison dominicale » au seuil de laquelle se tient Clotilde, notre présidente. Puis avec Guy Lapointe, notre pasteur, nous irons célébrer et prier.
Suivront des comptes rendus d’activités : la pastorale des enfants, la première communion, le Café du Sage et la musique, sans oublier ceux d’une conférence et d’un livre lu.
Reflétant la place prépondérante donnée aux enfants dans notre communauté, on y trouvera également des prières formulées par des premiers communiants et un credo pour le baptême d’un enfant.
Enfin, on lira cette invitation au bénévolat auprès des mourants, à l’action pour un monde sans pauvreté, une célébration poétique du pays et un « Qu’en pensez-vous? »
A TOUS ET À TOUTES, MERCI POUR VOTRE COLLABORATION, artisans des bulletins Invitations et Étapes et à vous les lecteurs!
Bonne lecture, bon été et bonne St-Jean! Élizabeth Roussel

A propos de votre maison dominicale…
Dans un contexte de rénovation et de réaménagement des lieux dominicains de la côte Ste Catherine, permettez-moi cette allégorie.
Quelle est-elle votre maison « dominicale »?
« La communauté chrétienne St-Albert-le-Grand! » me répondrez-vous puisque vous y êtes aujourd’hui même et tant d’autres dimanches! Une maison bien vivante où il y a de la place pour l’amitié, pour la beauté, pour la prière et le silence, pour l’écoute et l’accueil et pour un cheminement de foi. Nous nous entendons bien jusque là!
A quoi ressemble-t-elle? J’aime bien l’image de Guy Paiement et de sa « maison-roulotte » parce qu’elle possède une dynamique de mouvement.
Continuons. Une maison c’est fait de murs, et ces murs sont formés par toutes les personnes qui offrent bénévolement un peu, beaucoup, passionnément de leur temps pour faire en sorte que la demeure conserve sa solidité et sa forme. En cette fin d’année, un mouvement de reconnaissance monte pour toutes ces collaborations offertes généreusement. Prenez dans cette montagne de remerciements que je vous offre, votre juste part. Vous me suivez toujours?
Dans le cas présent, notre maison roulotte repose sur quatre pneus pour remplir sa vraie fonction : garder la route et par extension, garder le souffle de la communauté. Laissez-moi vous parler de ces quatre personnes qui sont au cœur des « roue-age » de la mécanique de la CCSA.
Il y a d’abord Guy Lapointe qui nous mène sans cesse sur le chemin d’une liturgie repensée, nomade, épurée et parlante. Ses différentes présences au comité de liturgie, à la tête d’une équipe liturgique, à l’initiation sacramentelle, à l’exécutif, au conseil de pastorale, au comité du site Web, au repas communautaire, à l’accueil dominical et à l’accompagnement des enfants comme conseiller, comme « idéateur » donnent de la perspective, de la vision et de l’ouverture à notre marche ecclésiale. De plus, son rêve actualisé de centre culturel chrétien vient combler une absence dans notre société québécoise et créer un lieu de réflexion possible. Comme il se plaît à le dire : « La naissance (de la communauté) est en avant ». Son élan est contagieux et sa foi en ce slogan porte l’avenir de notre communauté.
Il y a Muguette Lavallée qui assure l’orchestration musicale de toutes les composantes nécessaires aux liturgies. Chaque célébration des 52 semaines d’une année demande une gestation hebdomadaire car, pour contourner la répétition et la monotonie, il faut travailler à la carte.
Tant de choses à l’agenda qui entame la retraite dorée : participation aux réunions avec les équipes liturgiques, communications avec les chefs d’équipes, les présidents, l’organiste et le chantre, recherche de répertoire pour chaque célébration et pour la chorale, recherche d’instrumentistes, préparation des partitions pour l’organiste et pour la chorale ainsi que des préparations des feuillets pour l’assemblée, déplacements à St-Albert pour lier tous les éléments de chacune des célébrations et présence dominicale. Bien sûr, elle aime ce qu’elle fait mais cela ne demande pas moins un investissement considérable de temps pour obtenir la qualité de nos liturgies que tous apprécient et savourent! Hommage à sa fidélité et à sa persévérance!
Il y a Antoinette Dumas qui préside le secrétariat; bien discrète mais incontournable et essentielle au bon fonctionnement de notre communauté. Accueillir et répondre à tous les appels d’information, répartir les messages, gérer les babillards, mettre à jour le fichier, établir des calendriers, tenir les registres et faire les clarifications qui s’imposent à l’évêché, être gardienne du pouls structurel de notre communauté, entretenir une présence fraternelle auprès des absents et des affligés et en prime, sensibiliser notre communauté aux enjeux écologiques. Si le moteur baigne dans l’huile, la maison-roulotte peut envisager de paisibles kilomètres de voyage. Je salue sa précieuse assistance généreuse et remarquable!
Enfin la 4e roue c’est la présidence! Qu’y a-t-il dessous ce titre? De l’animation, de la coordination et de la communication tous azimuts! Quoi d’autres? Un amour pour cette grande famille communautaire et le sentiment gratifiant d’un service qui maintient une espérance et un accompagnement auprès de chrétiens-pèlerins comme elle. Mais chut! on se fera discret, car elle pourrait nous entendre, cette quatrième roue…
Profonds remerciements à tous et à toutes avant les vacances d’été et au plaisir de se revoir en cours de route ou à la Rentrée, le 11 septembre prochain. Ciao! Ciao!
Clotilde Pouliot
Post Scriptum à l'article de Clotilde Pouliot
De la quatrième roue, Clotilde parle trop peu. Une grande discrétion… Pour parodier une publicité souvent entendue : si Clotilde n’existait pas comme présidente de la communauté, il aurait fallu l’inventer. Cette femme a du caractère. On s’en rend compte. Oui, cet amour pour la communauté dont elle parle, il est bien réel. C’est cet amour qui lui fait prendre tant d’ínitiatives : l’attention aux personnes, le souci de les aider et de les accompagner dans toutes sortes de besoins; la dimension poétique qui habite cette femme la rend créatrice autant dans l’expression de la foi de la communauté que dans les diverses dimensions de la vie. Les quelques homélies qu’elle a prononcées en font foi. Un immense merci à Clotilde pour ce qu’elle représente, pour son leadership et pour son attention aux personnes.
Guy Lapointe
Célébrer et prier au cœur de l’action
A la suite de la conférence que j’ai donnée au Collège Dominicain à Ottawa, le 27 janvier dernier, à l’occasion de la remise de la Maîtrise en sacrée théologie, je soumets à Étapes ces quelques réflexions sur le sens de la liturgie. Même si elles pourront peut-être vous apparaître un peu abstraites, je crois que ces réflexions peuvent aider à donner du sens à nos célébrations…
La célébration liturgique, même en profonde régression dans bien des milieux chrétiens, reste une pratique inhérente et essentielle à notre vie de foi. Dans ces moments de célébration, ne s’agit-il pas en fait de revenir sur le site de notre mémoire croyante pour nous redonner l’intelligence et le goût des situations à explorer et pour nous ouvrir à l’assentiment ou mieux au consentement. Ce temps de célébration est un temps de souhait : souhaiter que la mémoire du Dieu de Jésus soit au cœur de notre action; souhaiter que cette rencontre historique de Dieu avec son peuple puisse se manifester et se continuer dans la qualité même de nos engagements. La célébration veut être ouverture à la fois aux enjeux et aux besoins de notre monde, et à la mémoire du Dieu qui en Jésus a ouvert un champ de vie et d’engagement pour construire ensemble l’avenir. Pour les chrétiens et les chrétiennes, célébrer, c’est souhaiter ce présent et cet avenir dans le rappel de l’Événement pascal, toujours présent à même notre action et à notre réflexion.
Ces moments de célébration veulent être un espace symbolique qui nous met en relation avec nous-mêmes avec les autres et, bien sûr, avec le Dieu de Jésus. La liturgie, aussi brève et simple soit-elle, est un moment qui donne à penser, puisque qu’il préside à la rencontre de nos projets, de nos engagements au cœur de la vie et devant Dieu. A cet égard, la prière comme la liturgie est un jeu joué devant Dieu. Elle nous met non seulement en présence de nous-mêmes et de Dieu, mais elle nous situe au présent… de nos responsabilités et de nos engagements.
La liturgie, dans ce qu’elle porte de meilleur, offre un espace et un temps de grâce. C’est fondamentalement un lieu, un espace, un moment poétiques où il ne s’agit pas seulement d’être présent, mais d’être au présent. La liturgie nous incite à rester créateurs et créatrices de vie et d’action. Elle fait appel à tous les sens. Elle met en mouvement. Elle peut nous faire voir et saisir que le monde que l’on veut meilleur appelle une transcendance, un regard vers un Absolu. Ce moment de liturgie et de prière est en quelque sorte une « perte de temps » en ce qu’il ne produit rien, en même temps qu’il peut ouvrir un espace; il donne à penser, nous amène à une sorte d’exhaussement du quotidien et de l’action. Ce moment est en quelque sorte un temps de marginalité, susceptible de nous aider à voir le monde et l’engagement autrement. Mais de quelle sorte de marginalité s’agit-il? Non d’une marginalité, qui nous épargnerait de regarder le monde en face et de l’habiter, mais une marginalité qui est plus que nécessaire pour penser et voir plus loin que notre propre action.
La liturgie et la prière, aussi brèves soient-elles, sont à la fois un entracte et un moment de veille. Un entracte qui n’est pas un alibi pour nous permettre d’échapper aux responsabilités de l’histoire. Nous célébrons « entre actes ». Cet entracte peut susciter et surtout rencontrer l’exigence de l’action. Et pour nous y tenir, la liturgie est aussi un moment de veille, une veille qui n’est pas diversion, mais qui peut prendre le sens d’une conversion. Pour qui entre en liturgie, même en un moment très court, il se met en mode d’attente, d’attente de soi et des autres, d’attente de Dieu. La veille nous révèle à nous-mêmes tels que nous voudrions être. Elle est un jeu symbolique de faire mémoire et de faire retour. A cet égard, la liturgie est un jeu de relations, d’hospitalité, un souhait d’incarnation dont le visage et la vie de Jésus restent les traces toujours à relire et à relier. C’est en somme un entracte et une veille pour vérifier et « prier » la qualité de notre être au coeur de l’action.
Soutenir la prière et la liturgie
Pour que la prière et la liturgie donnent à penser, il est nécessaire que l’espace de prière puisse être habité — et j’ajouterais — habité en poète. Pour y arriver, il importe de donner au langage liturgique une liberté d’expression. Et ce, à deux conditions : favoriser, quand le temps le permet, le partage d’une parole intelligente, sensible, intimement liée à l’événement ou à l’action à entreprendre ou à poursuivre; faire comprendre que cette parole inspirée de nos traditions croyantes et de la vie pourra susciter des gestes liés à l’événement. En somme, une parole qui suggère plus qu’elle ne dit, tout comme le sont les paroles poétiques ; des paroles qui recréent, qui donnent le goût de continuer à vivre et à s’engager.
Guy Lapointe
Méditation pour un credo
Je crois en Dieu
|
 |
Son souffle demeure
|
Pastorale des enfants à St-Albert : historique, bilan, perspectives
HISTORIQUE
C’est au début des années 1970 qu’André Gignac, o.p., a demandé à Thérèse Dufresne de mettre sur pied des liturgies de la Parole à l’intention des enfants. Tout de suite un principe s’est imposé, à savoir que les enfants doivent revenir dans la grande assemblée pour la liturgie eucharistique. C’est pourquoi cette activité est vraiment une liturgie de la Parole. On reprend avec les enfants l’Évangile du jour sauf si on le trouve trop difficile et on complète la liturgie avec une activité. Les premières années il y a assez d’enfants pour faire deux groupes : 6-9 ans et 9-12 ans. Plus tard, faute d’enfants et d’animateurs, on formera un seul groupe.
En 2001, avec l’annonce de la disparition de la pastorale scolaire et de l’enseignement religieux à l’école, la communauté s’interroge sur la façon d’assumer l’éducation religieuse des ses enfants. C’est encore Thérèse Dufresne qui initie le projet. Elle propose aux aspirants animateurs d’adopter le programme conçu par l’équipe de catéchèse de Notre-Dame-de-Grâce. C’est un programme réparti sur sept ans que nous projetons de couvrir en six. Chaque année se répartit en 3 étapes : l’Ancien Testament avant Noël, Jésus après Noël et Le Ressuscité à la suite de Pâques. Pour chaque célébration, la grande nouveauté est qu’on doit RACONTER l’épisode biblique plutôt que de le lire. Le programme s’accompagne d’un outil de travail très bien fait qui donne des pistes pour chaque célébration. Les célébrations sont plus élaborées qu’auparavant, c’est pourquoi on demande aux enfants d’être sur place pour 10h50. Le principe de retour dans la grande assemblée est maintenu.
Le groupe d’animateurs a décidé que le(s) coordonnateur(s) remplira un terme de 2 ans, non renouvelable. Le premier terme est assuré par Christine Mayr, le second, qui s’achève, par Jean-Marc et Geneviève Garant.
BILAN
Avec un premier cycle de six ans déjà complété aux deux tiers, le moment semble venu de tirer certaines conclusions provisoires. Une première constatation s’impose : malgré des appels répétés, la célébration peut rarement commencer à l’heure, ou, si elle le fait, on compte inévitablement des retardataires. Deuxièmement, le nombre de participants est extrêmement variable, avec une moyenne plus élevée au premier semestre. Troisièmement, l’âge moyen augmente et il faut en tenir compte dans la préparation des célébrations. Le groupe d’animateurs s’est déjà partiellement renouvelé. Après les départs à la fin de la deuxième année et une équipe réduite à huit la troisième année, nous avons pu compter cette année sur une douzaine d’animateurs. Toutefois d’autres départs sont à prévoir et le besoin de sang neuf se fait grandement sentir.
Le programme que nous avons adopté, bien qu’il soit excellent, ne correspond pas toujours aux souhaits de formation religieuse et d’unité liturgique. D’abord, il ne propose que 24 célébrations par année alors que nous en avons besoin, bon an mal an, de 34 ou 35. Ensuite, à la fin du cycle, si les enfants connaîtront bien l’Ancien Testament et les Évangiles, ils n’auront jamais reçu d’enseignement religieux formel. Enfin, l’arrimage avec la thématique de la grande assemblée est difficile. Tout l’automne est consacré à l’Ancien Testament. Les épisodes évangéliques sont regroupés en fonction du thème annuel du programme plutôt que du cycle des années liturgiques et ils sont traités pendant la période de l’année coïncidant en partie avec le Carême, ou les mêmes passages d’Évangile reviennent chaque année. La partie « Le Ressuscité » ne comprend que 4 célébrations alors que le nombre de dimanches entre Pâques et la fin de l’année varie de 8 à 12. Il nous faut donc compenser par des célébrations tirées de la 7e année du programme.
PERSPECTIVES
Avant tout, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Le programme que nous avons adopté, en particulier dans sa pédagogie, est excellent. Cependant, rien n’interdit de l’adapter à nos besoins de façon plus systématique que nous l’avons fait jusqu’ici. Dans l’immédiat, nous pourrions consulter le lectionnaire de l’année qui vient : si le thème de certaines de nos célébrations se retrouve dans l’un ou l’autre dimanche, nous pourrions ajuster notre calendrier. (Au premier semestre il faudrait consulter l’équipe liturgique car la grande assemblée n’utilise pas toujours la lecture tirée de l’Ancien Testament).
À moyen terme, il est possible de réaliser une adaptation plus générale. On peut réaménager les épisodes évangéliques pour les rapprocher du cycle liturgique. On peut approfondir certains thèmes en leur consacrant 2 dimanches : le premier pour l’épisode biblique, le deuxième pour de l’enseignement « formel ». (Ex : Récit du baptême de Jésus puis 2e célébration centrée sur le baptême). On pourrait aussi ajouter certaines célébrations avec des épisodes des Actes des Apôtres puisque actuellement « l’événementiel » se termine à la Pentecôte.
Geneviève Dumouchel-Garant
Prières composées par les communiants
Être chrétien,
Je trouve cela vraiment bien.
C’est se soucier de son prochain
Et préparer de meilleurs lendemains.
Parfois je prie Dieu
Et Il exauce mes vœux.
Je prie pour que tous aient un foyer
Pour qu’ils sachent apprécier.
Ce qui compte dans le monde
C’est que tout le monde soit joyeux
Et heureux.
Aujourd’hui
Je suis contente d’être ici.
Nous célébrons
Notre première communion.
C’est une étape du voyage
Vers le grand partage.
Sandrine McDuff (1er mai 2005)
Jésus, soleil du matin
Toi qui fais d’une merveille la nature
Gloire à toi et à tous ceux qui t’entourent
Tu nous enseignes la bonté
Et cela nous rend meilleurs
A tous les jours nous te rendons hommage
En pratiquant ta parole
Car ton message est un message d’amour.
Raphaël Grenier-Benoît (5 juin 2005)
Air de turbulence
Le 29 mai dernier, j’étais invitée au spectacle du groupe vocal : TURBULENCE …!… Seigneur, me suis-je écriée! Quel beau titre pour l’article du Bulletin Étapes, en ce qui concerne la préparation de la première communion… Car de la turbulence, j’en ai vu et vécu.
Arrivés des quatre coins du diocèse, à des samedis différents, j’ai rencontré durant quatre semaines, quatorze enfants de l’École Buissonnière et un de la Communauté Saint-Albert-Le-Grand.
Tels des papillons qui volettent de droite à gauche infatigablement… ils ont avancé sur la route de leur initiation chrétienne, cette route qu’ils ont empruntée le jour de leur baptême et sur laquelle se profilait leur première EUCHARISTIE, cette route qui, je l’espère, ils poursuivent à leur rythme dans leur paroisse respective…
Les présentations ont eu lieu le premier samedi : je leur avais préparé à chacun une valise sur laquelle ils se nommaient ainsi que leurs parents, mais sur laquelle aussi, ils nous mentionnaient ce qu’ils aimaient et ce qu’ils n’aimaient pas : leurs talents, leurs qualités et peut-être… un défaut. La présentation orale s’est révélée vive et enjouée! Afin de les préparer à la rencontre avec Nancy Delva dont l’enfant allait être baptisé le jour de la communion, nous avons réfléchi sur notre propre baptême symbolisé par : La fleur de mon baptême. La rencontre avec Nancy et son bébé a été fort intéressante et a suscité un échange. Ensuite ils ont dessiné leur propre portrait.
La semaine suivante nous avons parlé de la prière en général et des différentes formes de prières. Chacun a reçu une prière qu’ils ont illustrée pour afficher dans leur chambre.
A la troisième rencontre, GUY LAPOINTE est venu nous rencontrer pour échanger sur l’EUCHARISTIE et nous emmener dans l’église pour parler de la célébration. Il en a profité pour faire quelques recommandations sur la conduite…
Le dernier samedi a été consacré à des révisions et à la pratique de la célébration. Étant donné que les surprises ne manquaient pas à chaque semaine, ce jour-là il y avait des funérailles… Nous avons commencé la pratique dans une salle R2 transformée en église, avant d’aller sur les lieux même! Pendant ce temps, les parents ont préparé le repas communautaire, fort copieux et varié.
Les papillons voletaient toujours dans l’insectarium…
La joie que j’éprouve à préparer les enfants et mon grand sens de l’humour m’ont permis, contre vents et marées, de mener à bien cette tâche. Que tous ceux qui m’ont encouragée soient remerciés. Je vous renouvelle ma GRATITUDE ÉMERVEILLÉE.
Je n’ai rien à vous offrir que trois feuilles d’or
Qui auprès du lutrin viennent fleurir encor.
Mon humble témoignage essaime avec ferveur
Tout ce qu’avec joie, je médite dans mon cœur.
Mille mercis auréolés de lumière
Qui s’élancent vers DIEU telle une prière
Pour que votre appui source de bienveillance
Reflète dans la foi paix et espérance.Jocelyne Bérard
Le Café du Sage
Voici le rapport de nos activités pour 2004-2005
Au cours de cette année, nos échanges ont porté sur des thèmes de spiritualité. Dans une perspective de quête du sens de la vie, nous avons abordé et exploré l’estime de soi, la prière et l’héritage chrétien : comment le conserver et le transmettre dans le monde d’aujourd’hui. De plus, préoccupés par le phénomène de la mondialisation, nous avons maintenu un regard sur la consommation responsable. Plusieurs tableaux ont permis à l’Assemblée de prendre connaissance de notre démarche.
L’assistance comptait 14 à 16 personnes.
Antoinette Dumas, responsable.
Témoignages de quelques participants
« Chaque rencontre est préparée avec clarté et minutie par Madame Dumas, l’âme du groupe des « Sages » Environ une douzaine de fidèles se réunissent pour échanger amicalement sur des sujets d’ordre économique, social, spirituel etc. Chacun peut s’exprimer librement et sans prétention, approfondir sa propre réflexion et par là même celle des autres. »
Jacqueline Destez
« Le Café du Sage! Quel grand nom! Pourtant avec accueil de l’autre, simplicité et spontanéité, nous abordons différents sujets choisis par le groupe et profitons des connaissances et expériences de chacun des membres. Suite à nos échanges, nous avons fait part à la Communauté des fruits de nos rencontres : au lunch communautaire, nous avons osé aborder le phénomène de la mondialisation; placé des affiches à l’entrée de l’église et préparé une messe avec le célébrant. Grâce au dévouement d’Antoinette et à la fidélité des membres, nous nous quittons chaque année — non sans un bilan positif — en se disant à l’automne prochain. Un merci spécial à chacun pour ce qu’il est pour le groupe et ce qu’il nous fait partager avec tant de simplicité. »
Marie- Thérèse Rabeau
« En cette période de très grands changements sur le plan religieux, il est urgent que l’on s’attarde à penser à la sauvegarde de toutes les belles facettes du message d’amour, de sollicitude et de compassion que nous a laissé le Seigneur. Sur un plan concret, sur notre vaste terre humaine, ne faut-il pas réfléchir à la protection de la nature et à la lutte contre les excès de la surconsommation, le gaspillage de nos ressources sans oublier les méfaits de la pollution? L’an dernier nous avions décidé d’intercaler dans la célébration eucharistique du dimanche nos préoccupations de consommateurs envers l’eau, le pain, le vin et la Terre. Avec la collaboration dynamique du célébrant Richard Guimond, o.p., cette initiative du Café du Sage fut très appréciée en créant échange et réflexion. Je souhaite que plus de gens s’intéressent à ces rencontres, lieu d’amitié et de ressourcement. »
Jean Villemur
Bilan Musique
Être coordonnatrice du chant et de la musique à la communauté chrétienne de St-Albert-le-Grand, qu’est-ce à dire? En voici un aperçu, à partir d’un bilan déjà préparé par celle qui assume cet engagement pour chacun des 52 dimanches de l’année :
- Réunions : comité de liturgie et équipes qui préparent les célébrations;
- Communications avec les différents intervenants : chef d’équipe, président. organiste, chantre…
- Recherche de répertoire à adapter à l’orientation choisie par chaque équipe, (chants à plusieurs voix en priorité, pour «le plaisir » de la chorale).
- Préparation des partitions pour l’organiste, le chantre, la chorale, et des feuillets pour l’assemblée à copier et à aller porter à l’imprimerie, puis à St-Albert pour qu’à chacune des célébrations, tous les éléments soient en place, liés, selon l’expression déjà utilisée par Clotilde, « comme sauce béchamel ».
À signaler : L’apport important de la chorale comme support et stimulant du chant de l’assemblée. Le tout, grâce à la grande générosité d’Yves St-Amant, toujours là dès 10 heures, les dimanches où il anime, pour réchauffer les voix à même sa grande compétence en technique vocale et, en un temps record, obtenir une interprétation de plus en plus appréciée. Cet apport si précieux d’Yves est un des éléments qui m’encouragent à tenir le coup dans ce travail de coordination particulièrement exigeant durant les grandes périodes liturgiques.P.S. : Chapeau à Angelika Mayr pour tout le temps déjà consacré au classement des chants, à Margo Dallaire qui continue ce précieux service, et à Clothilde Dandenault chargée des appels aux membres de la chorale.
Muguette Lavallée
Chacun cherche son ange
C’est le titre que je vous propose. Sans doute va-t-il surprendre aujourd’hui, car la croyance aux anges, notamment à son ange gardien, c’est archaïque. Même que ça doit faire sourire les théologiens.
Pour ma part, quand on m’a offert ce livre ma réaction fut une hésitation de scepticisme. Je ne pense pas toutefois être la seule parmi les croyants à avoir remisé les anges depuis belle lurette. Il est loin le temps où je marchais au catéchisme et où je trouvais extraordinaires les histoires de l’Ange Raphaël, de l’Archange Gabriel. Oubliée aussi la définition du Petit Catéchisme qui présente les Anges comme des rois de Dieu.
Plus j’avance dans ma lecture, plus mes préjugés tombent et je retrouve la place des anges dans ma foi. De plus, quel beau personnage à présenter à ma petite fille de trois ans, Margot, qui ne se rassasie pas de mes histoires. Elle qui imagine toutes sortes de présence pour faire route avec elle, pour apprivoiser ses peurs, elle sera émerveillée de cette présence à laquelle je crois et que je lui ferai découvrir. L’Ange qui apparaît aux bergers dans la nuit de Noël pour leur annoncer la Naissance de Jésus a tout le merveilleux qu’il faut pour détrôner la Fée des étoiles. L’auteur, un moine bénédictin allemand du nom de Anselm Grün l’a écrit en 1999. Il s’inspire toujours des textes bibliques et des psaumes. Par exemple ce beau psaume 91 verset 11 : « Il a pour toi donner ordre à ses ANGES de te garder en toutes voies sur leurs mains, ils te garderont pour qu’à la pierre, ton pied ne te heurte. » Ailleurs dans l’Évangile de Mathieu, verset 28 1 à 8, à la Résurrection « ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus, il n’est pas ici car il est ressuscité, venez voir le lieu où il gisait et allez vite le dire à ses disciples. » Les figures évangéliques, continue l’auteur, sont toujours les messagères de l’Amour de Dieu. Voilà ma quête pour retrouver mon ange!
Grün Anselm M, Chacun cherche son âme, Ed. Albin Michel, 2000, 185 p.
Huguette Chagnon
Conférence d’Éric Edelmann sur la méditation
Le 17 mars dernier, j’ai dû faire le choix entre deux conférences : l’une du Centre culturel chrétien, sur l’avenir du patrimoine religieux, l’autre à l’auditorium, sur la méditation. Éric Edelmann, docteur en philosophie du Département des sciences des religions de la Sorbonne, y était invité par Méditation chrétienne du Québec (1), pour traiter le sujet suivant : « Dans un monde en mutation, la méditation comme voie de transformation ».
Devant une salle comble, le conférencier partagea ses idées et connaissances concernant la méditation et nous a parlé des différentes techniques nous permettant de bien se centrer, afin de mieux recevoir la présence de Celui en qui nous croyons et ainsi faire tomber les barrières à l’intérieur de nous-mêmes. Pour y arriver, cela demande de la rigueur, une posture où le corps est droit et relaxé, en somme « être bien dans son assiette ». Pour Edelmann, le mode de respiration est un facteur déterminant. Contrairement à la technique de John Main, il n’utilise pas de mantra.
Dans un siècle où le stress est de plus en plus prédominant, il est bon de constater qu’un théologien et philosophe, non seulement s’intéresse à la spiritualité, mais aussi à l’étude des méthodes de transformation de l’être humain même dans son aspect corporel. Ce dernier ne demande pas mieux que d'être serein, tout en composant avec un quotidien où le mental est trop souvent appelé à s’agiter fébrilement. S’arrêter tous les matins et faire table rase de tous les soucis, donne la possibilité à l’esprit de se situer, pour mieux fonctionner spirituellement, psychologiquement et intellectuellement devant les exigences souvent pressantes de la vie.
Les adeptes de différentes écoles de méditation furent comblés par la profondeur et l’ouverture d’esprit de ce conférencier qu’est Éric Edelmann. (2) (1)
(1) On peut rejoindre Méditation chrétienne du Québec à : (514) 525-4649
(2) Éric Edelmann est l’auteur de Jésus parlait en araméen, ed. du Relié, 2000. 461 p.
Il anime un stage de méditation en Estrie.Marguerite Bilodeau
D’UNE RIVE À L’AUBE
Le bénévolat par l’accompagnement aux mourants
J’ai raccroché la ligne, encore tout ébahie de ce que je venais d’entendre.
Voilà un homme que je ne connaissais pas, et qui, le temps d’une conversation téléphonique, m’a immergée avec aisance dans un sujet aussi difficile que la mort et l’accompagnement aux mourants. Un ton de voix ordinaire, mais quelle profondeur dans le choix des mots. « Vous savez… il y a quelque chose de merveilleux dans la mort. C’est une expérience apaisante, révélatrice du sens de la vie. La mort n’est pas morbide. C’est l’idée qu’on s’en fait; ce sont nos projections qui nous font peur. Avec du travail, on peut faire naître des idées plus positives. »
Quel travail? C’est celui d’un bénévole d’Une Rive-à-l’Aube, qui veut demeurer anonyme. Pour cet homme, aujourd’hui âgé, le contact avec la mort re-monte à sa jeunesse, alors qu’un problème cardiaque le condamne à brève échéance. De cette expérience naîtra une vocation, celle de l’accompagnement aux mourants.
Il y a une trentaine d’année, animé par son talent naturel pour l’empathie, et sans formation particulière encore, il accompagne son premier malade, le père d’une amie, pendant la phase terminale de son cancer. De ce premier accompagnement et de tous ceux qui suivront, il retient la leçon principale : l’humilité et la simplicité.
Le bénévole pose des gestes simples. Il devient les mains de celui qui n’a plus la force d’utiliser les siennes. Des mains affectueuses et respectueuses. S’assurer que le malade sent bon, qu’il est bien coiffé, humecter ses lèvres, son front, remonter la couverture… Ce bénévole insiste sur un environnement sobre et paisible; pas trop de couleurs, pas trop d’odeurs, des lumières tamisées. Le mourant a parfois besoin de solitude et a les sens particulièrement en éveil. Ce qu’on appelait autrefois « la grâce d’état. »
Le bénévole offre du temps. Une présence silencieuse, qualitative, qui met le malade au centre de ses préoccupations. Établir rapidement la confiance, créer une intimité, mais surtout, il faut écouter. Écouter beaucoup, avec la seule intention de comprendre. Et puis, lorsque le mourant le souhaite, aller plus loin dans l’expérience d’apprivoisement de la mort, voir les questions que le mourant se pose. La phase terminale d’une maladie stimule la question du sens de la vie et de la mort. Les valeurs spirituelles se manifestent alors. Les mourants, comme les autres humains, ont des croyances religieuses variées; ou ils disent qu’ils ne croient à rien. « Encore là, il faut être en ouverture pour chercher ce que « rien » veut dire. Souvent, « rien » veut dire que le mourant ne croit plus de façon naïve ou infantile, mais recherche quelque chose de plus profond. »
Peur de souffrir, peur d’étouffer… . Ce bénévole va aussi expliquer au mourant et à sa famille les étapes physiques de la marche vers la mort. Il peut établir des codes avec le mourant qui pourront le soulager lorsqu’il ne pourra plus parler. Quelques semaines, parfois quelques années après le premier contact, vient le décès. Le processus se com-plète avec la famille autour du défunt, au salon funéraire et aux funérailles. Et puis c’est le temps de se retirer. « Il ne faut pas fuir, mais je ne peux pas rester dans cette intimité qui appartient à la famille. Je suis entré dans leur intimité, mais eux n’entrent pas dans la mienne. Les gens qui restent se sentent extrêmement reconnaissants, mais ils ne sont aucunement redevables. Cette relation restera importante. Les familles le comprennent positivement. Si on se rencontre au centre d’achat, on se salue avec plaisir. »
L’intervention d’un bénévole aura permis à toute la famille d’accompagner le mourant vers la mort. Selon ce bénévole, il y a une nette différence pour le mourant et sa famille, entre être accompagné ou ne pas l’être. Ce que confirme une autre bénévole, une dame, cette fois. Une dame plus jeune, qui n’est pas une professionnelle de la relation d’aide, mais qui offre aussi son temps à accompagner les mourants, bénévolement. « Une personne qui vient d’apprendre un diagnostique sévère doit souvent gérer la souffrance de son conjoint et de ses enfants, en plus de la sienne. On dit beaucoup plus de choses à un bénévole qu’à sa famille. Le mourant ne se sent pas coupable de parler de sa souffrance. Il ne se sent pas jugé. C’est très libérateur pour lui. » Puisque nous avons nos questions et nos réponses en nous, l’écoute active de cette bénévole aide à conscien-tiser des choses et passer à une autre étape.
Les hôpitaux disposent d’une équipe pluridisciplinaire en soins palliatifs, mais qui est surchargée. Les bénévoles ont pour eux leur grande disponibilité, leur formation particulière et leur empathie naturelle. « Je n’ai pas de recette. Chaque rencontre est unique. Il faut y aller selon le besoin. L’important est d’être disponible, le reste est carrément imprévisibl », dit cette bénévole.
Comment vient-on à ce type de bénévolat? « Je voulais m’impliquer socialement. Je me suis sentie attirée vers ça. J’ai une facilité naturelle pour l’écoute. Dès mes premières rencontres sur le terrain, je me suis sentie à ma place… j’en retire beaucoup de feed-back positif. » Cette bénévole travaille aussi à former les nouveaux bénévoles en accompagnement avec d’autres formateurs. « C’est une très belle expérience », déclare t-elle. « Ces personnes sont particulièrement intenses. Je me sens privilégiée de travailler avec elles. »
Pour la Rive Sud
Pour avoir recours au service d’Une Rive à l’Aube, vous adresser à madame Gaby Bouvrette ou à sa représentante, au Centre d’action bénévole « Les P’tits bonheurs » au (450) 441-0807
Claudine Cusson

Qu’en pensez-vous?
En réponse à Jeannette Boulizon : « Et maintenant, je sais » Étapes, Pâques 2005, p. 2-3 « Une longue vie de recherches, d’études, pour appuyer une croyance, une espérance : la Résurrection? C’est un tombeau vide qui nous répond », dites-vous.
Et aussi : « Et pourtant Jésus a bien existé… né d’une Vierge… de la descendance de David… a fait de nombreux miracles et apparitions… Ces faits historiques sont-ils irréfutables? Y aurait-il quelque chose de plus à comprendre?… » Deux auteurs biblistes, reconnus et inspirés, répondent à cela :
- « Ce qui apparaît comme des « faits historiques » décrits dans la Bible, ne doit pas être pris au pied de la lettre. Nous devons réapprendre que les symboles transmettent une réalité qu’on ne saurait traduire dans un autre langage que le leur, qu’il y aurait des vérités inexprimables sinon sous forme de mythes, de sagas, de contes. Ainsi... « la naissance virginale est un symbole mystique, miracle de l’Âme et non du corps ». (1)
- « Qu’est que ces « faits historiques » veulent dire aujourd’hui? Certes pour tenter une réponse, est-il nécessaire de comprendre ce qu’ils voulaient dire jadis… Nous ne saurons sans doute jamais ce qui s’est passé dans la conception de Jésus. Il est bien possible que Marie et Jésus aient gardé pour eux leur lourd secret. Mais on sait que ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l’on méprise, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. » (2)
A vos autres questions, je répondrais moi-même simplement que ce n’est pas vouloir « tout prouver ou justifier », rationaliser, que de chercher à « découvrir et savoir, besoin essentiel, tendance profonde de notre nature », comme en parle si bien Teilhard de Chardin. Cela ne contredit en rien le don de la foi dont nous sommes gratifiés. Au contraire celle-ci en est éclairée, épurée. N’ayons pas peur! Joseph et Marie, sur le plan humain, un couple normal…
(1) Drewermann, Eugen, La parole qui guérit, Ed. du Cerf, 1993
(2) Myre, André, Maintenant la Parole, ed. Paulines, 2004Jeanne C. Auclair
 |
Fleur de mon pays |
 |
Fleur bien aimée, fleur de mon cœur,
Je te vois dans le ciel et sur la terre,
Malgré intempéries toujours tu fleuris
Ta toile est solide ton mât est bien droit,
Me rappelant les ancêtres de mon pays. (bis)Je regarde le drapeau, celui de mon pays
Flotter dans les airs, aux couleurs du ciel
Celle de la dignité, jusqu’à l’infini,
Tantôt il vogue, tantôt silencieux
Avec la croix et tes beaux lis blancs (bis)La croix sublime de nos croyances d’antan
Les fleurs fragiles de nos champs d’aujourd’hui,
Symbole de notre force et fragilité
La tête est bien droite, comme nos beaux sapins,
Tes pétales généreux comme nos hommes du temps (bis)Gens de mon pays, comme le drapeau
Tenez-vous bien droit et forts comme la croix
Souples comme la toile, libres comme le vent
Rayonnez comme soleil, qui vous émerveille,
Et beaux comme les lis qui poussent dans nos champs (bis)
Paroles et musique Marguerite Bilodeau
Comité de publication du bulletin ÉTAPES
Responsable : Élizabeth Roussel, eroussel@cam.org
Mise en page : André H. Rinfret, andre.h.rinfret@sympatico.ca
Illustrations : Jeanne C. Auclair
Communauté chrétienne St-Albert-le-Grand :
Adresse du site web : www.st-albert.org
Courriel St-Albert : info@st-albert.org
Communauté chrétienne Saint-Albert-Le-Grand à Montréal
Accueil Homélies Organisation Événements Célébrations Plan du site En haut
Accueil Homélies Organisation Événements Célébrations Plan du site En haut






